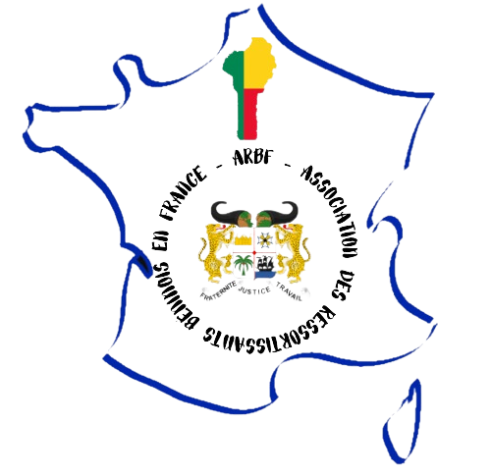L’Histoire de l’Association des Ressortissants Béninois de France (ARBF)
Par Faustin AÏSSI, Professeur émérite (Université du Littoral Côte d’Opale)
La création de l’Association des Ressortissants Béninois de France, en lien avec l’émergence des mouvements africains de jeunesse estudiantine comme l’AED (Association des Etudiants Dahoméens en France (AED), section de l’UGEED (Union générale des Elèves et Etudiants Dahoméens), de la Fédération des Etudiants d’Afrique Noire en France (FEANF) et de travailleurs comme l’Association des Travailleurs Dahoméens en France (ATDF), a été la résultante d’une longue démarche de ces associations et mouvements émergents qui prit ses racines à la sortie de la 2ème Guerre mondiale (1939/1944) où la participation des africains sous tutelle coloniale et envoyés au front sous l’égide des fameux « tirailleurs sénégalais » aura fondamentalement énormément pesé dans la victoire des alliés.
En effet, les Luttes des Peuples contre le capitalisme dans la première moitié du XXe siècle tant :
- européens dont celles des français pour l’obtention de leurs acquis sociaux par les mouvements de revendication de 1936 sous le Front populaire ;
- qu’africains à partir de 1944 avec l’émergence des mouvements de lutte pour l’indépendance et l’autonomie de développement conduisant aux droits acquis de siéger au parlement français en qualité de Député Non-citoyens pour Sourou Migan APITHY et de Député Citoyen pour le Père Francis AUPIAIS en ce qui concerne le Dahomey ;
Auront conduit les forces esclavagistes en présence à faire évoluer leur logiciel mis en place à la Conférence de Berlin en 1885 partageant l’Afrique et ses richesses sous domination coloniale des pays du Nord.
Après la 1ère Guerre mondiale de 1914/1918, les difficultés des économies occidentales conduisent au Crash boursier de Wall Street de 1929 avec des conséquences sociales qui aboutissent à la dévaluation du dollar de 41% en 1934, à l’arrivée du gouvernement du Front populaire en France en 1936 qui dans la foulée dévalue le Francs français tandis que les Britanniques organisent des « Marches contre la faim » dont la plus célèbre s’inscrivant dans l’Histoire aura été celle de Jarrow où une foule impressionnante de chômeurs se rassemble et prend la direction de Londres. Ces luttes sociales avaient payé puisqu’elles ont vu la signature du « Social Security Act » en 1935 aux Etats-Unis de même qu’en France avec l’apparition de la « Sécurité sociale » et des « Congés payés » en 1936.
Mais les origines de la seconde Guerre mondiale n’ont pas pour seules causes les crises économiques des années trente. Le Traité de Versailles signé le 28 juin 1919 par toutes les parties à l’exception de l’URSS extrêmement contraignant pour l’Allemagne notamment la démilitarisation de la Rhénanie, la soustraction à l’autorité allemande de toutes ses colonies de même que la Sarre et la Région de l’Ouest de son territoire très riche en Fer puis enfin les crises sociales non satisfaites dans les autres pays européens du Sud, ont conduit à la montée des partis nationalistes notamment en Italie (Benito Mussolini), en Espagne (général Franco) et bien sûr en Allemagne avec Adolf Hitler que le Président allemand Paul Von Hindeburg dut nommer Chancelier faute d’autres choix. Le Chancelier Adolf Hitler après avoir écrasé toute opposition put mettre en œuvre son idéologie du pouvoir développé dans son livre « Mein Kampf (Mon combat, écrit en 1924) ».
Adolf Hitler profita de la mort du président Hindeburg en août 1934 pour fusionner les postes de président et de chancelier puis s’autoproclama Chef de l’Allemagne connu sous la dénomination de « Führer ». Il s’engagea alors dans son rêve de réunification de l’Allemagne en promettant de réparer l’humiliation du Traité de Versailles et de faire retrouver à l’Allemagne sa grandeur en commençant par sa remilitarisation. Après le rattachement à nouveau de la Sarre à l’Allemagne en 1935, la Rhénanie en 1936, la réalisation de l’Anschluss (l’unification formelle de l’Allemagne et de l’Autriche), la poussée vers la Tchécoslovaquie, l’occupation de l’Albanie par l’Italie dans le cadre son alliance militaire « pacte d’acier » avec le « Führer » en 1939 puis l’invasion de la Pologne par l’armée allemande le 1er septembre, la Grande Bretagne et la France déclarèrent la guerre à l’Allemagne le 3 septembre afin disent-elles de « protéger les nations libres et indépendantes » de l’hégémonie allemande. Intervint une période de « drôle de guerre » sans affrontement direct entre les Alliés et les forces de l’Axe du « pacte d’acier » jusqu’en avril 1940 où l’Allemagne envahit la Norvège puis la les Pays-Bas et la France qui tombe en mai 1940. L’Italie envahit la Grèce en octobre 1940 et l’Allemagne occupa la Yougoslavie en 1941 puis envahit la Russie en juin 1941 par l’opération « Barbarossa ». Le conflit devient une guerre mondiale, lorsque le Japon attaqua la flotte américaine à Pearl Harbour le 7 décembre 1941 après avoir envahi la Chine orientale, entre d’un côté l’Axe militaire du « pacte d’acier » mais surtout l’armée allemande et d’autre côté la Grande-Bretagne, les Etats-Unis et le reste de l’Europe.
L’occupation de la France par les allemands lors de cette seconde guerre mondiale eut pour conséquence l’installation du régime de Vichy du Maréchal Pétain qui fit rentrer en résistance des nationalistes parmi lesquels les syndicats ouvriers et les communistes pendant que le Général de Gaulle préféra s’exiler à Londres et le Général Leclerc prit le chemin de l’Afrique qui devient ainsi tant le grenier à blé des français que le territoire à partir duquel s’organisait la résistance militaire. Le général de Gaulle qui n’avait pas à priori la confiance des alliés, imagine l’émergence d’un mouvement libre et pluraliste dont il confie la création à Jean Moulin le 1er janvier 1942 en même temps qu’il en fit son délégué personnel, montrant ainsi aux américains qu’il était le chef incontesté des Français libres depuis son appel du 18 juin 1940 au lendemain de la demande d’armistice du maréchal Pétain.
Il aura fallu attendre le 27 mai 1943 pour que se crée ce mouvement de coordination de la lutte contre l’occupation allemande : le Conseil national de la Résistance (CNR) où s’y retrouvent les Personnalités représentant les 8 grands mouvements de la Résistance, les tendances syndicales (CGT, CFTC) et politiques (PCF, SFIO, Parti Radical, Démocratie chrétienne ou Parti Démocrate Populaire ; Droite laïque ou Alliance Démocratique, Droite conservatrice ou Fédération Républicaine) hostiles à la politique de Vichy. Le CNR présidé par Jean Moulin adoptera son programme en mars 1944 prévoyant un « plan d’action immédiat » et des « mesures à appliquer dès la libération du territoire ».
Ainsi à la libération le CNR déclina son programme pour l’Outre-mer dont l’Afrique francophone et pour l’Hexagone dont on peut retenir principalement :
- Sécurité sociale pour tous : remboursement des frais médicaux et indemnités de chômage ;
- Retraite étendue à toutes les catégories de salariés sauf les commerçants ;
- Retour à la Nation des grandes entreprises comme Renault, SNCF, Air France etc. ;
- Subvention aux programmes culturels ;
- Liberté de presse et indépendance vis-à-vis des capitaux des grandes industries.
Quand aux pays francophones d’Afrique, une Conférence fut organisée à Brazzaville du 30 janvier au 8 février 1944 par le Comité français de libération nationale (CFLN) avec à l’ordre du jour le « Rôle et l’avenir de l’Empire colonial français ». Dans sa déclaration finale sous l’égide du Général de Gaulle, il fut acté l’Abolition du « Code de l’indigénat » et l’Abandon de la « politique d’assimilation en faveur des colonies » en même temps qu’il fut consacré le caractère « définitif » des liens entre la France et ses colonies où « toute possibilité d’évolution hors du bloc français et toute constitution, même lointaine, de self-government » est catégoriquement rejeté.
La seconde Guerre mondiale ayant vu la mobilisation forcée des centaines de milliers des ressortissants des territoires d’Outre – Mer par la Métropole coloniale française et par conséquent des dizaines de milliers de morts pour une guerre qui ne les concernait pas, les élites des pays colonisés des Territoires d’Outre – Mer et d’Afrique vont militer pour l’émancipation de leur pays d’origine et créer des Mouvements anticolonialistes, Partis politiques notamment le RDA ou et plus tard des Syndicats (UGTAN en 1957 ou Union générale des travailleurs d’Afrique noire, FETRANI ou Fédération des travailleurs d’Afrique noire immigrés regroupant toutes les associations des travailleurs immigrés dont l’ATDF en ce qui concerne le Dahomey appelée plus tard ATBF quand le pays devient Bénin, FEANF ou Fédération des étudiants d’Afrique noire en France dont l’AED/Section de l’UGEED (Association des étudiants dahoméens et Union générale des élèves et étudiants dahoméens).
Il convient de noter :
- Les personnalités fondatrices du RDA : Félix Houphouët-Boigny, Modibo Kéita, Ahmed Sékou Touré, Doudou Guèye, Joseph Félix Corréa, Sourou Migan Apithy, Yacine Diallo,Fily Dabo Sissoko, Gabriel D’Arboussier, JeanFélix Tchicaya ;
- La composition du RDA à la veille des indépendances de 1960 : Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), Union soudanaise (US), Union démocratique sénégalaise (UDS, exclue en 1955), Union des populations du Cameroun (UPC jusqu’en 1951), Parti progressiste nigérien (UPN), Parti démocratique de Guinée (PDG, jusqu’au référendum de 1958 où la Guinée vota NON à l’entrée dans la communauté française), Union démocratique voltaïque (UDV), Parti progressiste tchadien (PPT), Parti progressiste congolais (PPC).
A partir des années 60, tous ces partis qui ont été à l’avant-garde de l’accession aux indépendances nominales des pays francophones sont rentrés dans l’histoire.
Les Associations des travailleurs, Syndicats et les Mouvements de jeunesse notamment les Fédérations estudiantines continueront d’exister mais rentreront progressivement en léthargie ou seront interdits. Leur résurgence interviendra pour ce qui concerne le Bénin à partir de la Conférence nationale des Forces vives des 19 au 28 février 1990 à laquelle par exemple Faustin AÏSSI assista porteur d’un amendement constitutionnel sur la gouvernance préconisant non pas le Régime présidentiel pur et dur retenu mais un Régime semi-présidentiel avec un Président Chef de l’Etat et un Premier Ministre Chef du Gouvernement, en qualité Président da la Section de Lille de l’ATBF.
En effet, la participation active des organisations de la Diaspora notamment française avec ses 17 délégués représentant leurs différentes associations, fédérations et ONG pesa fortement sur la Conférence obtenant pour la France, l’ouverture d’un Consulat général à Paris, des Consulats honoraires en province avec possibilité de nomination de Consulats honoraires franco-béninois, et pour la Diaspora un ministère des Béninois de l’Extérieur préalable à la préparation des textes relatifs au vote des Béninois de l’Extérieur lors des élections législatives et présidentielles dans leurs lieux de résidences et à leur éligibilité en qualité de Béninois de l’Extérieur.
L’arrivée au pouvoir de Mathieu Kérékou au printemps 1996 l’amènera à convoquer dans la foulée d’abord une Conférence nationale économique du 15 au 19 décembre 1996 à Cotonou dont l’une des résolutions conduira à tenue de la Conférence nationale des Béninois de l’Extérieur un an plus tard du 15 au 19 décembre 1997 qui verra la naissance du Haut Conseil des Béninois de l’Extérieur (HCBE) nécessitant la réorganisation complète des associations des Béninois de l’Extérieur sur tous les continents. L’ARBF jouera un rôle important dans cette réorganisation de la communauté associative nationale française en offrant toute la logistique nécessaire à la création, sur son territoire à Villeneuve d’Ascq le 8 mai 1999, du Conseil des Béninois de France (CBF) et l’élection de son 1er Président en la personne de Pierre FAYEMI avec Gad GODONOU comme Vice-président. L’ARBF adhérera officiellement au CBF à Chaponost à Lyon en automne 1999.
PERSPECTIVES
Tout ceci nécessita la réorganisation de la communauté béninoise du Nord de la France et en conséquence celle des associations. Il faudra attendre l’accession du Président Kérékou à son second mandat pour la mise en œuvre de certaines résolutions de la Conférence nationale relatives à la Diaspora.
Au printemps 1994, une réunion de l’ATBF s’est tenue chez Servais Tomavo, au cours de laquelle Faustin a cédé la présidence à Servais Tomavo. Un nouveau bureau a été formé, composé de Servais Tomavo en tant que Président, Victorin Salanon comme Vice-Président, Jean d’Almeida en tant que Secrétaire général, Eliane Aïssi comme Trésorière, et Rogatien Hounfodji en qualité de Trésorier adjoint.
Ce bureau a alors décidé d’élargir l’association en prenant contact avec les étudiants, afin qu’elle ne soit plus réservée aux seuls travailleurs. Une assemblée générale, réunissant travailleurs et étudiants, s’est tenue à l’automne 1994, aboutissant à la création officielle de l’ARBF.
Ainsi, Servais Tomavo a été le dernier président de l’ATBF et le premier président de l’ARBF.
À l’avenir, l’ARBF compte poursuivre ses efforts pour faire rayonner ses territoire, renforcer les liens communautaires, promouvoir l’inclusion sociale, et défendre les droits des ressortissants béninois en France. Elle envisage également de développer des partenariats avec d’autres associations et organisations partageant des objectifs similaires, et multiplier ses actions en faveur des jeunes et seniors de la régions.
SIÈGE SOCIAL
Le siège de l’ARBF est situé au 17 Allée des Saltimbanques, 59650 Villeneuve d’Ascq. Cependant, l’association se réserve la possibilité de transférer son siège social en tout autre lieu, après approbation lors d’une Assemblée Générale régulièrement convoquée à cet effet.
« Nous vous invitons à rejoindre l’ARBF dans cette belle aventure de solidarité, de partage et d’engagement au service de la communauté béninoise en France. Ensemble, nous pouvons construire un avenir meilleur pour tous. »
Le Président,
Thierry HOUNTOMEY